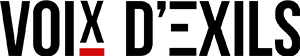Les enclaves espagnoles au large des côtes marocaines
Il existe au bord de l’Afrique continentale deux villes appartenant au Royaume d’Espagne: Ceuta et Melilla. Ces dernières constituent les seuls territoires terrestres de l’UE sur le continent africain. De ce fait, elle est en proie à de graves crises migratoires et de différends diplomatiques.
Melilla et Ceuta ont une longue histoire remontant à l’Antiquité. Ceuta a été successivement occupées par les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains et les Byzantins. En 711, les arabes musulmans ont conquis Ceuta, en faisant de cette dernière, une porte d’entrée pour l’expansion musulmane en Espagne. Melilla, quant à elle, a également une histoire ancienne, avec des traces d’occupations phénicienne et carthaginoise. Toutefois, elle a connu moins de changements de mains que Ceuta. En 1415, Ceuta fut conquise par le Portugal sous le règne de Jean 1er. Cette conquête marqua le début de l’expansion portugaise en Afrique du Nord. Cependant, en 1580, avec l’union ibérique, Ceuta passa sous le contrôle de l’Espagne, malgré la restauration de l’indépendance portugaise en 1640. Melilla, fut conquise par les espagnoles en 1497, peu après la prise de Grenade, le dernier bastion musulman en Espagne.
Situation géographique
Ceuta, située de l’autre coté du détroit de Gibraltar et à seulement 14 kilomètres de la côte européenne, servait principalement de tête de pont pour les flux commerciaux entre les deux rives. Quant à Melilla, située sur la partie la plus orientale du Rif marocain, elle répondait à la nécessité d’un port et d’une base, d’où soutenir la lutte et la sécurité du Royaume d’Espagne contre la piraterie. Les frontières actuelles des deux enclaves ont été établies au cours du XIXe siècle, en grande partie par les accords entre l’Espagne et le Maroc après la guerre hispano-marocaine de 1859-1860. Les traités signés à cette époque ont permis à l’Espagne de maintenir sa souveraineté sur ces deux territoires, malgré les revendications marocaines récurrentes.
Coalition militaire
Durant la première moitié du XXème siècle, l’Espagne était responsable d’un protectorat qui comprenait le nord et le sud du Maroc. Un accord conclu avec la France faisant suite au traité de Fès. Au cours de cette période, Ceuta et Melilla, conservant leur statut de territoires espagnols, servirent d’épicentre à l’administration colonial et militaire, afin de garantir le contrôle du protectorat. Le mandat pris fin lorsque la France accorda l’indépendance au Maroc le 7 mars 1956. Pris de court, l’Espagne est contrainte de restituée les zones détenues. Dans un premier temps le nord, suivi du sud en 1958.
Pressions migratoires
Cette situation unique en fait des points de passage stratégiques pour les personnes migrantes tentant de rejoindre l’Europe. La crise migratoire aux frontières de ces enclaves est un problème persistant depuis plusieurs décennies, exacerbé par les inégalités économiques, les conflits et les politiques migratoires restrictives de l’Union européenne.
Depuis les années 1990, Melilla et Ceuta ont vu un nombre croissant de personnes migrantes tenter de franchir leurs frontières. Ces personnes proviennent principalement d’Afrique subsaharienne et d’Afrique du Nord, mais aussi d’Asie et du Moyen-Orient. Elles entreprennent des voyages périlleux à travers le désert, affrontant les dangers des passeurs et des conditions climatiques extrêmes pour atteindre ces enclaves. Pour répondre à cette pression migratoire, l’Espagne avec le soutien de l’UE a fortifié les frontières de Melilla et Ceuta en érigeant des clôtures de plusieurs mètres de haut équipées de barbelés et de technologies de surveillance. Ces mesures visent à dissuader les tentatives de passages clandestins, mais elles ont également entrainé des tensions diplomatiques avec le Maroc qui estime que ces mesures violent ses droits souverains et humanitaires. La situation a donné lieu à plusieurs incidents violents. Par exemple, en 2021, Ceuta a fait la une des journaux lorsque plus de 8000 personnes, dont de nombreux mineurs, ont traversé la frontière en quelque jours, profitant de la relative passivité des autorités marocaines. Cette crise a mis en évidence ces tensions, souvent exacerbées par des questions diplomatiques plus larges, comme la reconnaissance du Sahara occidental.
En conséquence, les personnes arrivant à franchir ces frontières se retrouvent souvent dans des centres de rétention surpeuplés, confrontées à des procédures d’asile longues et incertaines. La gestion de la migration dans les zones de ces enclaves continue d’être sujet de débat intense dans l’Union européenne qui est divisée entre la nécessité de sécuriser ses frontières et l’obligation de respecter les droits humains.
Zana Mohammed, rédacteur à Voix d’Exils