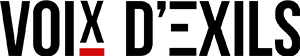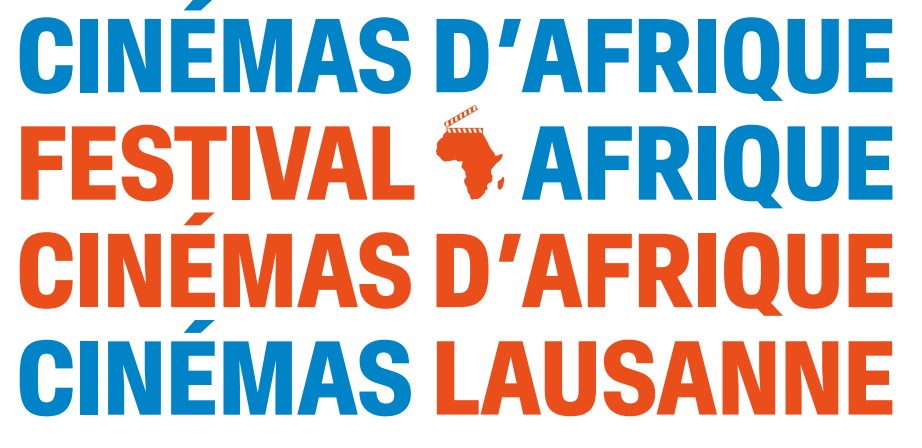Relations ambiguës au sein de la diaspora africaine en Suisse
En Suisse, les communautés africaines reflètent une diversité souvent méconnue. Si les associations jouent un rôle clé pour créer du lien et favoriser l’entraide, les divisions liées à l’histoire, à la politique ou à la religion freinent parfois la coopération. Cet article explore les tensions, mais aussi les ponts qui se construisent, entre personnes africaines vivant en Suisse.
De nombreuses personnes venues du continent africain vivent, travaillent, étudient, élèvent leurs enfants et participent à la vie sociale en Suisse. Certaines sont là depuis plusieurs années, d’autres viennent d’arriver. Les raisons de leur venue sont très diverses : demande d’asile, études, regroupement familial, situations économiques ou politiques. Pourtant, dans les médias suisses, on parle peu de cette diversité africaine. Elle est souvent réduite à une seule image, ce qui empêche de comprendre sa richesse, mais aussi ses difficultés.
On parle parfois d’unité africaine : l’idée d’un continent uni malgré ses différences. Mais dans la réalité, cette unité n’est pas toujours facile. En Suisse, comme ailleurs, il existe des tensions entre personnes originaires des différents pays ou régions d’Afrique. Ces tensions peuvent être anciennes ou récentes. Elles proviennent du passé colonial, de conflits armés, de rivalités politiques, de différences religieuses ou tout simplement de malentendus. Il y a également de la stigmatisation entre personnes africaines découlant de la lutte pour la reconnaissance et des préjugés internalisés.
Entre solidarité et repli
Certaines personnes ressentent de la méfiance ou des tensions au sein même de leur communauté. Dans leur ouvrage Logique de l’Exclusion, Elias et Scotson soulignent que « comme les établis sont habituellement mieux intégrés et plus puissants, ils sont en mesure, par induction mutuelle et mise au ban des sceptiques, de donner un solide étayage à leurs croyances. » Les auteurs expliquent certaines tensions par le fait que les habitants pensent que les nouveaux arrivants ne partagent pas les mêmes valeurs qu’eux. Ils ont donc peur que ces « nouveaux » changent leur manière de vivre et évitent de trop les fréquenter au quotidien. Ils ne les acceptent pas dans les lieux de prise de décisions, ni dans les associations, les clubs ou les églises. Ce rejet peut continuer pendant deux ou trois générations, notamment à cause des rumeurs et des commérages qui circulent.
Il ne s’agit pas ici de racisme au sens habituel, ni de peur de perdre son travail. En effet, tous – anciens et nouveaux – ont le même type de métier : ils sont ouvriers ou petits employés dans les mêmes usines. Ce rejet de l’autre vient d’un besoin de garder le pouvoir : le groupe qui est déjà installé veut garder sa place et rester uni. Pour cela, il met à l’écart ceux qu’il considère comme différents. Cette idée de « groupe supérieur » aide chacun à se sentir plus important et à mieux se définir à l’intérieur de cette catégorie.
Certains conflits d’origine politique ou ethnique refont également surface. Par exemple, des personnes refusent de collaborer à cause d’un conflit qui a eu lieu entre leurs deux pays d’origine, alors les opposants politiques évitent les individus proches des anciens régimes. De plus, des différences religieuses, notamment entre chrétiens, peuvent créer des distances. De nombreuses personnes préfèrent rester dans leur propre communauté nationale, ayant peur d’être mal jugées ou ne se sentant pas à l’aise avec les autres groupes. Le repli communautaire devient ainsi une forme de protection.
Plusieurs responsables d’associations regrettent ce manque de coopération entre communautés africaines. Il y a peu de projets communs, peu de communication et il existe parfois une certaine retenue dans les relations. Ce phénomène empêche une voix africaine unie de se faire entendre dans l’espace public suisse.
Défis partagés : logement, emploi, marginalisation
Les communautés africaines en Suisse font face à des défis communs, qu’elles soient originaires d’Afrique de l’Est, de l’Ouest ou du Nord. L’accès au logement est difficile, en particulier pour les familles nombreuses ou les personnes racisées. Les discriminations sont fréquentes. L’emploi est souvent précaire, surtout pour les personnes qui n’ont pas pu faire reconnaître leurs diplômes ou qui ne maîtrisent pas encore bien la langue. Les jeunes nés en Suisse vivent parfois un conflit d’identité entre la culture de leurs parents et celle de leur pays de naissance. Les femmes africaines, souvent très actives dans la vie associative, sont pourtant invisibilisées. Elles cumulent plusieurs difficultés : sexisme, racisme, précarité. Les personnes âgées souffrent parfois d’un isolement extrême, car elles sont loin de leur famille ou ne comprennent pas bien le système suisse.
Ces problèmes sont communs à beaucoup de communautés africaines, mais trop souvent, chacun les affronte seul. Pourtant, s’unir pour les dénoncer, pour proposer des solutions ou pour dialoguer avec les institutions suisses, serait bien plus efficace.
Les associations, essentielles pour le lien social
Malgré les obstacles, certaines personnes s’engagent pour rassembler la diaspora africaine. Dans plusieurs villes suisses, les acteurs associatifs africains sont d’une grande importance. Ces associations sont comme une grande famille, un lieu de solidarité où chacun peut trouver du soutien, être écouté et recevoir des conseils.
Des associations comme Co-habiter informent les gens sur leurs droits, les aident à mieux comprendre ce qu’est le racisme en ligne et leur montrent comment se défendre. Elles organisent des séances d’information dans des lieux du quotidien, comme les salons de coiffure ou les petits magasins, pour que tout le monde puisse y participer facilement. Plusieurs associations soutiennent également les nouveaux arrivants avec des questions de langue, de logement ou de procédures administratives.
Les associations africaines sont essentielles. Elles créent des ponts entre les cultures, soutiennent les personnes vulnérables et sont un exemple d’engagement collectif. Offrant des espaces de dialogue, de solidarité ou de prière, elles luttent contre l’isolement, en particulier chez les femmes et les personnes âgées. Finalement, elles permettent aux membres des diverses communautés de rester unis face aux difficultés et leur donnent de la force afin de vivre dignement en Suisse.
Se rassembler pour célébrer les diversités
Certains événements, comme des festivals interculturels, des conférences, des soirées de discussion ou des réseaux professionnels, sont des bons exemples de ce travail unificateur. À Baulmes, par exemple, le Festival Yelen célèbre la culture africaine. On y mange ensemble, on y danse, on y discute : ces moments permettent de recréer du lien, loin de la solitude que vivent beaucoup de personnes exilées.Un autre exemple inspirant : celui de l’association UMUSURUSURU, qui rassemble chaque année à Yverdon-les-Bains les personnes burundaises vivant en Suisse pour célébrer leur patrimoine culturel. Les sons des tambours « Ingoma » résonnent alors comme un appel à l’unité, non seulement entre Burundais, mais entre tous les Africains.
Ces événements deviennent donc des lieux de partage, de mémoire et de fierté identitaire. La présence d’autres communautés, par exemple rwandaises ou congolaises, renforce cette idée d’unité africaine au-delà des frontières. Loin de leurs pays d’origine, ces personnes qui se rassemblent comprennent la richesse de leur diversité et l’importance de se soutenir mutuellement. L’intégration dans le pays d’accueil ne signifie pas l’effacement des origines. Au contraire, c’est l’occasion de partager sa culture et de tisser des ponts entre les peuples.
Dans cette optique, l’unification des personnes africaines peut se construire à travers des projets culturels communs, des partenariats et des moments de célébration. En se réunissant autour de leurs racines, les membres de la diaspora africaine renforcent leur solidarité et transmettent aux générations futures un message d’espoir, d’unité et de fierté.
Vers une voix africaine forte et unie en Suisse ?
Aujourd’hui, il existe un besoin réel de représentation commune. Beaucoup de personnes issues de la diaspora africaine souhaitent être écoutées, être respectées, être reconnues dans leurs contributions à la société suisse. Cela ne signifie pas qu’il faut oublier les différences culturelles ou les histoires propres à chaque pays. Mais cela veut dire qu’il est possible de construire une solidarité nouvelle, plus large, plus inclusive. Une solidarité qui prend en compte la diversité, mais qui travaille à des objectifs communs : la dignité, les droits individuels, l’intégration, et le vivre‑ensemble.
Construire cette unité ne sera pas simple. Il faudra du temps, de la confiance, du dialogue. Mais les premières pierres sont déjà posées. À travers les festivals, les associations, les réseaux, les initiatives citoyennes, la diaspora africaine montre qu’elle a un rôle essentiel à jouer dans la société suisse d’aujourd’hui.
Mossi Bigirimana
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils
Illustration: Desola Lanre-Ologun – Unsplash