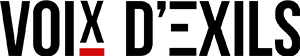Les récits de l’exil prennent vie en plein centre de Lausanne
Une étape poignante et engagée du Tour de Suisse de l’humanité s’est tenue sur la place Saint-François, au cœur de Lausanne, du 9 au 13 juillet. Cette exposition itinérante, initiée par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), a transformé l’espace public en un lieu de dialogue, d’écoute et de réflexion autour de l’exil et de l’asile.
Un immense livre interactif, dans lequel les visiteurs pouvaient entrer physiquement, constituait sans aucun doute un élément central de cet événement. À l’intérieur, des textes, des photographies et des vidéos retraçaient les parcours de personnes ayant été contraintes de fuir leur pays. Ces récits, profonds et sincères, ont permis aux passants de se confronter à la réalité humaine de l’exil, au-delà des chiffres et des discours politiques.
Sont venues s’ajouter à cette installation des lectures publiques, des performances théâtrales, des tables rondes et des écoutes de podcasts, qui ont permis à la place Saint-François de se transformer en une scène vivante d’expression et de rencontre. Les thématiques abordées — intégration, accueil, mémoire collective — ont favorisé des échanges riches et ouverts entre habitants, artistes, réfugiés et professionnels de terrain.
À travers cette démarche, le Tour de Suisse de l’humanité visait à replacer l’humain au centre des récits migratoires. À Lausanne, cette mission a résonné fortement : les regards curieux, les questions spontanées, les émotions partagées ont témoigné d’une réelle volonté de comprendre et de s’engager.
Cette halte lausannoise faisait partie d’un parcours national plus vaste, qui a également traversé Neuchâtel, Lucerne, Saint‑Gall et Zurich. A Lausanne comme dans ces autres villes, le message est resté le même : la solidarité est une force, et l’hospitalité un choix de société.
Théâtre de rue : quand le racisme ordinaire prend vie sur scène
Le samedi, une performance de théâtre de rue percutante a interpellé les passants. Deux femmes sur scène : l’une est migrante, l’autre lausannoise. Leur échange commence banalement, puis glisse rapidement vers une confrontation tendue où s’expriment préjugés, agressivité et fatigue accumulée. La femme locale, méfiante et acerbe, accuse les étrangers de « prendre toute la place ». La femme migrante, calme mais ferme, lui répond sans détour.
Avec une mise en scène dépouillée mais d’une intensité émotionnelle remarquable, la pièce a recréé une situation tristement familière — celle d’un quotidien où le racisme ordinaire s’exprime sans qu’on s’en rende toujours compte. Le spectacle a invité chacun à réfléchir : combien de fois avons-nous entendu ce type de discours dans la rue, dans les transports, dans les médias ?
Dialoguer par le théâtre : entretien avec Salma Lagrouni
Le même jour, une rencontre a eu lieu autour du thème « Femmes migrantes et exil : le théâtre comme espace de parole, de dénonciation de violence et de mobilisation », en présence de Salma Lagrouni, metteuse en scène et présidente de l’association Women in Action International.
Elle a partagé son expérience personnelle et artistique, en montrant comment le théâtre peut devenir un espace de voix retrouvée, un lieu de dignité et de transformation. Pour les femmes en exil, la scène devient un véritable espace de guérison, de solidarité et de résistance. Avec sincérité, Salma a parlé de douleur, de courage, et de cette langue universelle : celle des émotions.
Selon elle, le théâtre est un espace de confrontation douce, une forme unique de dialogue que ne permettent pas les débats publics souvent figés ou polarisés. Ce n’est pas simplement un outil artistique, mais un miroir émotionnel de la société. Le spectateur est invité à ressentir avant de penser — et c’est dans ce ressenti que commence la prise de conscience. Là où les mots échouent, les émotions éveillent, secouent, transforment. Le théâtre devient ainsi un lieu d’écoute, de remise en question, de transformation intérieure.
Quand elle travaille avec des femmes réfugiées, Salma insiste sur un point essentiel : il ne s’agit pas de les “aider”, mais de reconnaître leur puissance. Ces femmes, souvent marquées par la guerre, l’exil, les pertes successives, ne montent pas sur scène comme des victimes, mais comme des porteuses de récits, de mémoire, de vie. Le théâtre leur offre une plateforme pour occuper l’espace, prendre la parole et reprendre possession d’elles-mêmes. C’est un geste de guérison, certes, mais aussi un acte politique, profondément humain et émancipateur.
Salma remet également en question le vocabulaire habituel, notamment le mot « intégration », qu’elle trouve réducteur. Ce mot, explique-t-elle, suppose un mouvement à sens unique, comme si les personnes exilées devaient s’adapter à une norme prédéfinie. Or, ces femmes arrivent avec une histoire, une culture et une éducation riches. Leur vie ne commence pas à zéro. Plutôt que d’intégration, elle préfère parler de rencontre, d’échange mutuel, de sensibilité réciproque. Leurs récits sont traversés par la souffrance, certes, mais aussi par une immense puissance de vie.
Au fil de son parcours, certains moments l’ont profondément marquée. Lors d’une répétition, une comédienne n’a pas pu continuer une scène : un souvenir douloureux est remonté d’un coup. Ce fut un moment suspendu, bouleversant. Le théâtre, rappelle Salma, est aussi un espace fragile, qui demande une grande écoute et une bienveillance constante. Un mot, un geste peuvent raviver une blessure enfouie. Mais c’est aussi cela qui rend ce processus si humain, si nécessaire, si profondément transformateur.
Oleksandra Yefimenko
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils









Photos: rédaction Voix d’Exils