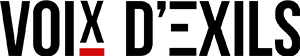Plaidoyer pour un droit à la famille sans conditions
Le 10 septembre 2025, à Genève, l’association elisa-asile a réuni juristes, psychologues et travailleurs sociaux autour d’un thème crucial : le regroupement familial. Intitulée « Réunir », cette journée de formation traitait des défis juridiques, psychologiques et humains que vivent les familles de personnes séparées par l’exil. Entre lenteurs administratives, souffrance psychique et droits des enfants, la formation a rappelé l’urgence d’un regard plus humain sur le regroupement familial. Au fil des échanges, une conviction s’est imposée : réunir les familles, c’est aussi réparer les vies.
D’entrée de jeu, Najma Hussein, juriste auprès d’elisa-asile, a dressé le tableau complexe du cadre légal fédéral. En Suisse, le droit au regroupement familial dépend du statut du séjour : un réfugié reconnu peut, sous certaines conditions, faire venir ses proches se trouvant à l’étranger. Mais les personnes admises provisoirement (permis F) ou en cours de procédure d’asile (permis N) doivent patienter des années, prouver leur autonomie financière et disposer d’un logement adéquat. Les démarches varient d’un canton à l’autre et les ambassades exigent parfois des documents impossibles à fournir. Cette complexité transforme un droit fondamental en parcours administratif épuisant, souvent vécu comme une injustice. « Entre la loi et la réalité, il y a des années d’attente, de séparation et de souffrance », a rappelé Najma Hussein.
L’impact psychologique de la séparation
Pour la psychologue Émilie Pento, de l’association Appartenances Genève, la séparation familiale agit comme une blessure invisible. Les réfugiés et requérants d’asile sont quatre à six fois plus exposés aux troubles psychiques que la population générale. Dépression, anxiété, stress post-traumatique : autant de symptômes aggravés par la peur pour les proches restés au pays, l’attente interminable ou l’incertitude des procédures. « On demande aux réfugiés de s’intégrer pour pouvoir prétendre au regroupement familial. Mais comment s’intégrer quand on vit dans la peur et le manque ? », interroge-t-elle. Le regroupement familial, selon elle, n’est pas qu’un acte administratif : c’est un facteur de santé publique et un levier de résilience. Retrouver sa famille, c’est retrouver une raison d’avancer.
L’intérêt de l’enfant au cœur du processus
Le Service social international (SSI), représenté par Dicky Ndoye et Marine Zurbuchen, a centré son intervention sur les droits des enfants séparés de leurs parents. Selon la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), « l’intérêt supérieur de l’enfant » doit guider toute décision. Mais dans les faits, les procédures sont souvent pensées pour les adultes, oubliant les besoins émotionnels et culturels des mineurs. Le SSI œuvre pour protéger, localiser et préparer les enfants avant et après leur arrivée en Suisse, plaidant pour que les professionnels adoptent une approche centrée sur l’enfant, au-delà du visa et des formalités. « Réunir un enfant avec sa famille, c’est lui redonner une sécurité affective et une chance de grandir normalement », souligne Marine Zurbuchen.
Réunir pour reconstruire
Au cours de la journée, un fil rouge s’est tissé : la réunification n’est pas un privilège, mais un droit fondamental. Chaque intervenant a rappelé que la famille constitue le premier espace de soin et d’intégration. Loin des siens, l’exilé se fragilise ; entouré, il se reconstruit.
L’après-midi a été consacrée à une table ronde émouvante, où d’anciens requérants d’asile ont partagé leurs témoignages. Ces hommes et ces femmes, autrefois séparés de leurs proches, ont raconté comment ils ont réussi à surmonter la pression psychologique et les barrières administratives, souvent grâce à l’accompagnement d’elisa-asile.
La formation « Réunir » a ainsi mis en lumière un enjeu de société important : penser les politiques migratoires non seulement en termes de contrôle, mais aussi de bien-être et de cohésion humaine. Se rappeler qu’il y a des vies en suspens, des enfants qui grandissent seuls, des parents qui s’efforcent d’espérer. En Suisse comme ailleurs, reconnaître le droit de vivre en famille, c’est reconnaître la dignité de chaque être humain.
De la théorie au vécu
Ce que j’ai entendu tout au long de la journée n’est pas qu’une réflexion théorique : c’est une réalité qui m’affecte directement. Comme beaucoup d’autres, j’ai laissé une femme et deux enfants au pays. Et même si la distance se mesure en kilomètres, elle se vit surtout en silences, en inquiétudes et en manques.
Écouter ces juristes, ces psychologues et ces anciens requérants d’asile m’a rappelé qu’il y a des histoires d’amour, de liens et de patience qui sont ignorées. Le regroupement familial n’est pas seulement une question de droit : c’est une question d’équilibre intérieur, de santé et de dignité.
Tant que des familles resteront séparées par des barrières politiques ou administratives, notre humanité collective demeurera incomplète. Si le mot « Réunir » résonne encore en moi, c’est parce qu’il dit à la fois l’attente, la douleur… et l’espoir.
Yahya Nkunzimana
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils