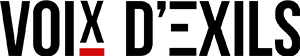Un impact psychologique au-delà des frontières
Quand quitter son pays devient une nécessité, la souffrance ne s’arrête pas aux frontières. Ce texte donne la parole au silence intérieur de celles et ceux qui fuient. Il rappelle qu’avant d’être des « réfugiés », ce sont d’abord des êtres humains.
Dans un contexte de guerres et de persécutions, des millions de personnes n’ont d’autre choix que de tout quitter pour survivre. Mais, si les corps traversent les frontières, les esprits, eux, portent les cicatrices du déracinement. On parle de statistiques et de statuts juridiques, mais rarement de la douleur invisible : celle qui pèse sur le cœur et sur l’âme, celle qui freine la reconstruction.
Ce texte veut rendre visible ce que les mots peinent parfois à illustrer : l’anxiété, la solitude, les pertes affectives et la résilience silencieuse de ceux et celles qu’on oublie trop souvent. Il rappelle que l’accueil ne se résume pas à un toit, mais qu’il doit aussi être un soin, une écoute, une main tendue.
Un départ forcé, une douleur invisible
La migration, surtout lorsqu’elle est forcée, n’est jamais un banal déplacement géographique. C’est un bouleversement profond qui affecte autant le corps que l’esprit. Selon Victor Frankl, psychiatre autrichien et survivant de la Shoah, l’être humain peut supporter presque tout à condition de trouver un sens à sa souffrance. Or, dans l’exil, le sens est souvent perdu.
Beaucoup racontent que leur départ a créé un vide existentiel. Un jeune homme afghan rencontré dans un foyer nous a dit : « Avant, je savais qui j’étais : un fils, un étudiant, un voisin. Ici, je ne sais plus quel est mon rôle, je ne suis qu’un numéro de dossier ». Pour certains, le simple fait de ne pas pouvoir travailler ou étudier équivaut à une seconde condamnation. Cette perte de sens fragilise l’équilibre psychique : les projets de vie s’effondrent, laissant place à un sentiment d’inutilité et de désespoir.
Derrière le départ se cache ainsi une réalité solitaire : celle des blessures psychologiques.
La perte de repères et d’identité
Les réfugiés laissent derrière eux bien plus que des lieux : ils abandonnent une langue, une culture, des repères, parfois des proches, toujours des souvenirs. Ce déracinement, que l’on peut rapprocher de ce que le psychologue Erik Erikson, psychanalyste germano-américain, qualifiait de « crise d’identité » dans le développement de l’enfant, engendre un profond sentiment de désorientation, de solitude, voire de mal-être. Ne plus savoir où est sa place traduit une rupture de continuité entre le passé et le présent.
Boris Cyrulnik, neuropsychiatre français, souligne d’ailleurs l’importance de la mémoire affective pour reconstruire un récit de soi cohérent. Beaucoup de personnes exilées évoquent une perte d’appartenance et des difficultés à se réapproprier leur identité dans un nouvel environnement. Les souvenirs, les objets du passé ou encore la séparation d’avec les proches ravivent ce sentiment de vide. Une mère burundaise explique : « J’ai appris la langue, mais je ne me reconnais plus dans la femme que je suis devenue. Dans mon pays, j’étais respectée, ici je suis dépendante de l’aide sociale ».
L’angoisse de l’avenir et l’incertitude permanente
L’avenir devient flou pour les personnes en exil, confrontées à une incertitude constante : « Pourrons-nous rester ? Serons-nous acceptées ? Où et comment reconstruire notre vie ? » Cette instabilité alimente l’anxiété, le stress post-traumatique et l’hypervigilance.
Aaron Beck, psychiatre américain et fondateur de la thérapie cognitive, a montré que les pensées négatives automatiques telles que « je ne suis pas en sécurité » et « je ne m’en sortirai pas », entretiennent les troubles anxieux. Incapables de se projeter, beaucoup peinent à se concentrer sur le présent et vivent dans une attente douloureuse, sans savoir ce que demain leur réserve. Cette absence de contrôle et de visibilité renforce leur mal-être.
L’attente des décisions d’asile constitue une épreuve en soi. Pendant des mois, parfois des années, les demandeurs vivent suspendus à une réponse administrative qui déterminera leur avenir. « Je dors avec mon téléphone dans la main, de peur de manquer l’appel de mon avocat », raconte un jeune demandeur d’asile. Une autre ajoute : « Chaque courrier dans la boîte aux lettres me fait trembler, je revis le traumatisme du départ ». Ces procédures, souvent opaques et longues, deviennent elles-mêmes une seconde source de traumatisme.
L’intégration : un parcours semé d’embûches
Dès leur arrivée en Suisse, la majorité des personnes migrantes doivent passer par les auditions du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Ces entretiens, censés établir la crédibilité de leur récit, sont souvent vécus comme un traumatisme supplémentaire. Cet aspect est d’ailleurs souligné par les psychologues de l’association Appartenances, que nous avons rencontrés. Ceux-ci affirment que la souffrance psychique est souvent utilisée comme critère de véracité d’une histoire, mais qu’elle peut également empêcher des personnes sous le choc de raconter leur passé de façon linéaire. De plus, des pauses dans un récit causées par l’émotion sont parfois interprétées comme un moyen stratégique pour gagner du temps et réfléchir à ce que l’on va dire : « J’ai dit la vérité, mais on a pensé que je mentais parce que je m’arrêtais pour pleurer », témoigne un réfugié burundais.
S’intégrer dans un nouveau pays implique ensuite d’affronter des barrières linguistiques, culturelles et sociales. Les personnes réfugiées sont souvent confrontées à des stéréotypes, à l’isolement, voire au rejet. Cela peut renforcer un sentiment d’exclusion et faire ressurgir une souffrance enfouie.
Pour les personnes ukrainiennes arrivées massivement depuis 2022, ces défis sont vécus avec beaucoup de difficulté. Une femme écrit sur les réseaux sociaux : « Je souris pour mes enfants, mais chaque soir, je pleure en silence, car je ne sais pas si nous pourrons rester ici ». Une autre personne partage également : « Je me sens comme un fantôme, invisible parmi les autres, je ne comprends pas les règles, je n’ose pas demander ».
Une femme ukrainienne nous a raconté en pleurant qu’elle avait énormément de mal à s’adapter en Suisse, car elle n’est plus si jeune. Professeure de langue ukrainienne, elle est contrainte de travailler comme femme de ménage. De plus, pour une raison qu’elle ne comprend pas, elle et sa fille ont été logées dans des villes différentes, ce qui l’attriste profondément. Les barrières administratives, l’incompréhension culturelle et la difficulté à faire reconnaître ses compétences professionnelles sont des sources majeures de souffrance. Nombreuses sont les personnes réfugiées qui, malgré leurs qualifications, doivent recommencer des formations entières, ce qui alourdit leur sentiment de perte et d’inutilité.
La culpabilité du survivant
La culpabilité du survivant est un phénomène bien documenté en psychologie traumatique. Elle apparaît notamment lorsque le survivant estime avoir eu plus de chance que ceux qui sont restés ou décédés. Judith Herman, psychiatre américaine et spécialiste des traumatismes, estime que cette culpabilité peut empêcher le processus de guérison.
Le survivant ressent un conflit moral entre la joie de survivre et la peine d’avoir quitté les autres. À ce propos, une réfugiée congolaise partage : « J’ai honte de rire avec mes enfants ici alors que ma sœur est encore cachée, là-bas. Je me sens coupable d’avoir eu la chance de fuir ».
Se reconstruire passe aussi par l’acceptation de cette réalité, sans s’accuser de ce qui ne dépend pas de soi.
Le besoin d’écoute et de soins psychologiques
La douleur liée au départ, la perte de repères, l’incertitude permanente, les difficultés d’intégration et la culpabilité du survivant nécessitent une écoute professionnelle et des soins adaptés. Trop souvent négligé, ce besoin est pourtant fondamental. Les troubles liés à l’exil sont réels : insomnies, stress post-traumatique, dépression, douleurs psychosomatiques, voire une perte totale de confiance en soi. Pour avancer, il faut pouvoir parler, être écouté, se sentir compris. Cela n’est cependant pas facile, comme en témoigne une réfugiée ukrainienne sur les réseaux sociaux : « Je suis allée chez un psychologue, mais il ne comprenait pas ce que je ressens. Comment expliquer ce que c’est que de perdre toute sa vie en un jour ? »
Peu de personnes réfugiées ont accès à des soins psychologiques et psychiatriques adaptés. Parfois à cause de la langue, parfois à cause du manque de structures ou de professionnels formés à la complexité du vécu migratoire. Pourtant, celles et ceux qui ont pu bénéficier de groupes de parole, même en ligne, évoquent un net soulagement et un regain d’optimisme.
Des initiatives pour reconstruire l’espoir
Heureusement, dans de nombreuses régions, des initiatives locales sont là pour aider les personnes migrantes. Elles proposent des cours de langue, des formations professionnelles, des groupes de parole, ou tout simplement des lieux de rencontre. Ces espaces permettent de retrouver une forme de stabilité, de créer du lien social et, petit à petit, de se reconstruire.
À Lausanne, l’association Appartenances déjà citée propose des thérapies interculturelles où les personnes réfugiées peuvent s’exprimer dans leur langue maternelle. Il y a aussi l’association Droit de rester qui soutient les requérants d’asile dans leurs procédures juridiques et administratives, tout en leur offrant un accompagnement social. À Genève, des ateliers de cuisine rassemblent des femmes exilées autour d’un savoir-faire commun, redonnant un sentiment d’utilité. Ces petites graines d’espoir rappellent que l’intégration passe aussi par l’humain.
D’un point de vue thérapeutique, la psychologie positive, par exemple, met l’accent sur les forces de la personne, sa résilience et ses ressources internes. Les initiatives citées plus haut montrent que l’espoir peut renaître, même après les pires épreuves, et elles aident à redonner confiance et dignité à ces personnes souvent en grande difficulté psychologique. La parole, le lien social et la reconnaissance de l’histoire personnelle sont des leviers puissants pour rebâtir une estime de soi.
Pour un accueil digne et humain
La migration n’est pas seulement un déplacement. C’est une épreuve humaine. Face à cette épreuve, nous devons être nombreux à répondre présents. Accueillir, ce n’est pas seulement offrir un abri, c’est aussi recevoir les histoires, les blessures, les forces de chacun. Toutefois, il faut reconnaître une part de responsabilité institutionnelle. Si la souffrance psychologique est si forte, c’est notamment parce que les structures d’accueil ne répondent pas toujours aux besoins. L’attente interminable, les procédures déshumanisantes et le manque de soins spécialisés aggravent les blessures initiales.
Accueillir dignement, ce n’est pas seulement ouvrir les frontières, c’est aussi garantir un accompagnement humain et psychologique à celles et ceux qui portent déjà un lourd fardeau. Parce que derrière chaque personne migrante, il y a une histoire. Et chaque histoire mérite d’être respectée.
Yahya Nkunzimana et Oleksandra Yefimenko
Membres de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils
Photo: Shimabdinzade – Pixabay