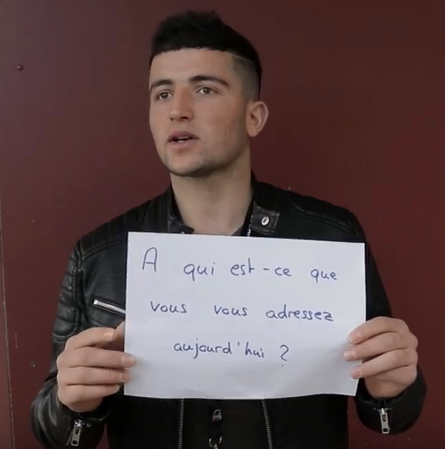Une famille vivant dans le squat. Photo: Nasser Tafferant
Des chercheurs du Pôle de recherche national suisse LIVES ont analysé et retracé l’histoire d’un squat urbain peuplé de migrants situé dans la région lausannoise. Cette recherche a donné lieu en parallèle à une exposition. Pour mieux comprendre les enjeux sociaux et politiques du phénomène étudié, nous avons interviewé M. Nasser Tafferant, chercheur au Pôle national de recherche LIVES et membre de l’équipe ayant investigué sur le squat.
Au plus fort de l’hiver, durant les premiers mois de l’année 2012 jusqu’à l’expulsion de ses habitants par les autorités en avril, une équipe du Pôle de recherche LIVES « surmonter la vulnérabilité : Perspective du parcours de vie » a mené une enquête en investiguant sur les cercles de relations amicales, familiales et de couples des habitants du squat des jardins familiaux de Vidy à Lausanne en Suisse. Cette recherche avait pour objectif de mieux comprendre les trajectoires des migrants vivant dans ces cabanons de fortune et les modes de régulation politique des problèmes d’exclusion sociale. L’enquête a, en parallèle, donné lieu à une exposition intitulée « LIVING THE SQUAT, Countdown of an Expulsion », qui s’est tenue à l’Université de Genève du 15 au 29 juin 2012 et à la Haute école de travail social et de santé de Lausanne du 1er octobre au 1er novembre 2012. Elle visait à montrer au public la vie matérielle et sociale du squat à l’approche de son évacuation, tout en retraçant les parcours de vie de ses habitants à la croisée de deux regards : celui du chercheur et celui du photographe.
Voix d’Exils : Vous avez présenté une exposition intitulée « Living the squat » à Lausanne, en octobre dernier. Son sujet était la vie des migrants qui ont squatté les jardins familiaux de Vidy de janvier à avril 2012. Pouvez-vous nous dire quel était l’objectif de cette exposition ?
M. Nasser Tafferant : L’objectif de cette exposition a été de rapporter des éléments d’information concernant l’expérience vécue par certains migrants d’un squat à ciel ouvert, sous le regard des passants ordinaires, à proximité du quartier de la Bourdonnette. Il importe de signaler que nos observations ne portaient pas exclusivement sur les Roms, mais aussi sur d’autres individus en provenance de pays d’Europe et d’Amérique latine et du Sud (ces derniers migrants ayant d’abord transité par l’Espagne). Cela a son importance, puisque la stigmatisation des Roms était, entre autres formes, consécutive aux effets d’annonce de certains médias locaux qui associaient systématiquement les mots « squat » et « Roms » dans quelques articles, encourageant, par-là, certains lecteurs anonymes à rendre public un discours anti-Roms.

La récupération. Photo: Nasser Tafferant
L’exposition rend compte de hétérogénéité des parcours de vie et de l’épreuve commune d’un squat urbain. Nous avons passé quatre mois – de janvier à avril 2012 – sur le terrain parmi les migrants et quelques suisses cohabitant dans les jardins familiaux de Vidy – du collectif de la Bourdache – jusqu’à leur expulsion définitive. Notre approche se voulait compréhensive, c’est-à-dire que nous voulions saisir les interprétations personnelles et collectives des (més)aventures au quotidien dans et hors du squat. Nous avons mobilisé des techniques sociologiques de recueil d’information en procédant, avec leur accord, à l’enregistrement de témoignages, à des observations distancées et en situation de vie dans les jardins. Nous avons, en outre, pris plusieurs photos témoignant des modalités d’ancrage dans le squat, d’une part, par la façon d’occuper et d’aménager les cabanons, d’autre part, par les formes de sociabilité (liens de famille, de couple, de camaraderie propices à l’entraide, mais aussi rapports de méfiance et, parfois, de tension virulente).
Enfin, l’affaire des jardins familiaux de Vidy ayant fait grand bruit au gré des circonstances liées aux mesures d’expulsion, nous avons porté notre attention sur la manière dont le squat des jardins familiaux de Vidy a été traité politiquement, médiatiquement et perçu par quelques riverains.
Pour quelle raison vous êtes-vous intéressé à ce mode de vie ?
Avant tout, je ferai preuve de prudence avec l’expression « mode de vie », qui ne colle pas du tout à la réalité des destinées individuelles et familiales des migrants que nous avons rencontrés dans le squat. Autrement dit, les habitants des cabanons ne mènent pas une vie de squatteur. C’est le squat qui s’est imposé à eux, par chance d’abord, puisque les cabanons étaient inhabités, par stratégie de survie ensuite, à l’approche des saisons d’automne et d’hiver qui furent rigoureuses. Il a fallu aux habitants beaucoup d’audace, d’inventivité, de confiance en soi et d’entraide pour faire l’expérience du squat dans ces conditions. Certains ont enduré cette épreuve jusqu’à leur expulsion définitive (soit presque une année passée dans les jardins familiaux), d’autres ont pris la route un matin, sans jamais revenir sur leurs pas, en quête d’une situation moins inconfortable ailleurs en Suisse ou à l’étranger. Comprendre leur sensibilité, la manière dont se dessinent les trajectoires, la régulation politique des problèmes d’exclusion sociale…, ce sont là des thèmes qui intéressent chacun des membres de l’équipe ayant participé à cette étude (Raul Burgos Paredes, Emmanuelle Marendaz Colle, et moi-même*) et, par extension, les équipes du Pôle de recherche nationale Lives – « Surmonter la vulnérabilité : perspective du parcours de vie » dont nous sommes membres.
L’exposition a-t-elle suscité une prise de conscience auprès du public et auprès des politiques qui l’ont vue ?
Si nous nous intéressons aux personnes ayant effectué le déplacement pour voir l’exposition – les riverains, les anciens occupants des jardins familiaux, les chercheurs et les étudiants intéressés par la question –, alors je réponds oui. Car l’exposition montre clairement comment, à plusieurs reprises, le traitement politique de l’expulsion du squat a été dysfonctionnel. Concernant la réception de l’exposition par les acteurs politiques, je ne peux faire de commentaires, ne les ayant pas rencontrés, aussi bien dans les moments de vernissage que lors des visites guidées. Il faut aussi dire que l’exposition n’a pas fait l’objet d’une grande visibilité. En 2012 il y a eu deux installations, une à l’Université de Genève, une autre à l’EESP de Lausanne. Nous espérons que 2013 sera propice à une plus grande visibilité.
Que sont devenus les migrants avec lesquels vous avez été en contact pour votre étude ?

La destruction du squat. Photo: Nasser Tafferant.
Entre janvier et avril 2012, nous avions tissé des liens étroits avec une quinzaine d’individus. Au cours de cette période, certains ont pris la route vers l’étranger soit pour retrouver leur ville d’origine ainsi que leur famille – Roumanie, Espagne –, soit pour bénéficier d’un dispositif d’accueil plus efficace, des actions de solidarité (notamment associatives) et nourrir l’espoir de gagner plus d’argent – dans ce cas la France était une piste privilégiée. S’agissant des personnes qui sont restées jusqu’au terme de l’avis d’expulsion, la perspective de certains a été de se maintenir à Lausanne sans qu’aucune mesure tangible de relogement ne leur soit proposée. Nous avons donc perdu leur trace pour l’ensemble, et avons croisé une personne en situation d’errance urbaine et de mendicité au centre ville.
Parmi les migrants, il y a une majorité de Roms. Quelles sont les structures d’accueil officielles accueillant les Roms pendant la saison hivernale ?
Les structures d’accueil officielles renvoient à celles déjà existantes, lesquelles proposent leurs services aux plus démunis. On peut citer le Sleep-in qui offre un gîte pour la nuit, la Soupe populaire qui offre le repas du soir et le Point d’eau qui permet de laver son linge et de faire sa toilette. Au cours de l’hiver 2012, les occupants des jardins familiaux ont notamment eu recours à la Soupe populaire et au Point d’eau. Ils ont cependant affiché une réticence à se rendre au Sleep-in, préférant le confort relatif des cabanons et un entre soi plus rassurant. Il existe, enfin, l’association de solidarité Opre Rrom, dont le siège se trouve à Lausanne, et qui œuvre à assister les Roms dans leurs combats quotidien contre l’exclusion et leur quête de reconnaissance. Ces acteurs associatifs ont suivi de près l’affaire des jardins familiaux de Vidy, manifestant un soutien indéfectible.
En tant que chercheur, avez-vous des pistes à suggérer pour améliorer les conditions de vie des Roms, améliorer leur image au sein de la population et permettre ainsi d’éviter leur exclusion ?
Aussi modeste que fut notre travail de terrain, notre objectif a été de sensibiliser les citoyens à la question du traitement politique des Roms et des migrants qui ont occupé les jardins familiaux de Vidy. Porter un regard différent, tendre l’oreille, se rendre sur place, s’informer auprès d’associations vouées à accompagner ces communautés laissées pour compte, ce sont là des touches d’attention qui contribuent à briser les jugements de valeur et à faire un grand pas. Je peux citer le cas d’un riverain qui m’avait accueilli à son domicile pour témoigner de la situation du squat dans les jardins familiaux de Vidy. La vue de son balcon donnait sur les cabanons. La proximité des occupants le dérangeait et, comme bon nombre de ses voisins, il perdait patience face à l’expulsion qui tardait à venir. Les choses prirent une nouvelle tournure lorsque la municipalité autorisa les occupants du squat à y passer l’hiver. La personne décida alors de changer de perspective sur la situation de ces voisins d’en bas. Depuis sa fenêtre, il prit le temps de bien les observer. La présence d’enfants dans le froid cinglant de l’hiver le heurta péniblement. Il prit alors la décision d’aller à la rencontre d’une famille et de leur faire don de vêtements chauds, de couvertures et de denrées alimentaires. La famille le remercia chaleureusement et ils finirent par tisser des liens, multipliant les rencontres, les deux parties pouvant communiquer en espagnol. Son jugement devint ainsi plus objectif au fil des semaines. Ce n’était plus la présence des squatteurs qui le gênait, mais les conditions dans lesquelles ils étaient maintenus ici, livrés à eux-mêmes, dans l’indifférence de tous. Il tint alors les décideurs politiques pour responsables de cette situation, il ne fut pas le seul d’ailleurs, d’autres riverains ont manifesté leur désarroi. Certes, l’homme en question souhaitait voir les occupants des cabanons quitter les lieux à la venue du printemps, mais dans le respect de leur dignité. C’est sans doute là un exemple manifeste de compréhension et de sagesse, dans la limite de moyens d’action de chacun.
*Au sein du pôle de recherche NCCR LIVES, Raul Burgos est doctorant, Emmanuelle Marendaz Colle est conseillère en communication, tandis que Nasser Tafferant est post-doc senior.
Lamin
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils
Infos:
Un cycle de conférences sur le thème de la vulnérabilité dans les parcours de vie est organisé par le Pôle de recherche national LIVES et l’Institut d’études démographiques et du parcours de vie de l’Université de Genève les jeudis du 21 février au 23 mai 2013.
Ces conférences sont ouvertes au public et l’entrée libre.
Pour en savoir plus, cliquez ici