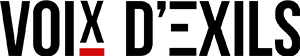Frappes ciblées, répression du régime et angoisse de la diaspora iranienne
Entre le 13 et le 24 juin 2025, le Moyen-Orient a de nouveau été secoué par une crise sécuritaire qui a dépassé le cadre militaire pour pénétrer la vie quotidienne de millions de personnes. Bien que, comme son nom l’indique, « la guerre de 12 jours » entre Israël et la République islamique d’Iran a duré moins de deux semaines, ses effets se font encore ressentir dans les esprits, dans les rues partiellement détruites de Téhéran, dans les maisons abandonnées et sur les réseaux sociaux censurés. Derrière les bombes se cachent également la répression par le régime des personnes afghanes exilées, et l’angoisse de la diaspora. En réalité, ce conflit qui a pu sembler n’être qu’une confrontation entre deux états, a aussi mis en lumière une fracture profonde entre le régime iranien et son peuple.
La guerre de 12 jours a pour origine différents événements des précédentes décennies : la révolution islamique de 1979, mais également l’invasion du Liban par l’armée israélienne à partir de 1982, pendant laquelle l’Iran a financé la lutte armée libanaise, et le Hezbollah par la suite. De plus, le programme nucléaire iranien est l’un des facteurs principaux des tensions actuelles, car l’état d’Israël se perçoit comme cible potentielle d’une future arme atomique et en fait une ligne rouge absolue.
Ces tensions se sont également ravivées avec l’attaque du 7 octobre 2023, perpétrée par le Hamas contre Israël, ayant causé la mort de centaines de civils. Des rapports du renseignement américain, relayés par le New York Times et d’autres médias internationaux, ont révélé le rôle crucial de l’Iran dans la planification, l’entraînement et le soutien logistique de cette opération. Selon ces sources, l’Iran aurait collaboré avec le Hamas pendant plusieurs mois, bien que Téhéran ait nié toute implication. Après des mois d’affrontements indirects à Gaza, au Liban du Sud et en Syrie, Israël a finalement décidé de répondre directement sur le territoire iranien. D’autres accusations de la part de responsables israéliens, comme celle d’une tentative d’attentat sur l’ambassade d’Israël en Azerbaïdjan, ont servi de prétexte pour une série de frappes contre des sites militaires en Iran.
Entre douleur et sentiment de justice
Cette guerre a dévasté des vies civiles. Et pourtant, beaucoup de personnes iraniennes ont aussi ressenti une satisfaction amère : parmi les cibles des frappes israéliennes figuraient des hauts gradés du Corps des Gardiens de la Révolution islamique – les mêmes généraux qui, depuis des années, dirigeaient la répression contre la population. Certains de ces officiers avaient ordonné de tirer à balles réelles sur des manifestants pacifiques lors des soulèvements de 2009, tandis que d’autres avaient supervisé la torture, les exécutions arbitraires ou encore la surveillance numérique de millions de citoyens. Le peuple iranien connaissait bien leurs noms et les avait vus dans les vidéos de propagande, dans les discours menaçants, et parfois même lors des procès truqués diffusés à la télévision d’État.
Pour beaucoup de familles brisées par ces années de répression – ayant perdu un fils, une sœur ou un ami dans les rues, dans les prisons ou dans les centres de détention clandestins – la mort de ces généraux a représenté une forme de justice inattendue. Le peuple iranien, désarmé, muselé, privé de recours et de justice dans son propre pays, n’avait jamais eu la possibilité de se venger ou d’obtenir réparation. Cette guerre, bien que venue de l’extérieur, a frappé là où les civils n’avaient jamais pu le faire.
Le pouvoir de l’État n’est pas issu des urnes mais d’un système verrouillé par le Conseil des gardiens de la Constitution et le Bureau du Guide suprême. Le peuple iranien l’a prouvé à plusieurs reprises, notamment lors du Mouvement vert de 2009 après une élection présidentielle contestée, et plus récemment avec le mouvement « Femme, Vie, Liberté », né en 2022 après la mort de Mahsa Amini, symbole de la révolte contre l’oppression du régime. Ces soulèvements massifs ont exprimé clairement que ce régime n’est pas le choix du peuple.
Exode de Téhéran et expulsion des réfugiés afghans
Avec les attaques israéliennes frappant quotidiennement les alentours de Téhéran et de Karaj, la panique s’est installée. Des milliers de familles ont fui la capitale, entraînant d’immenses embouteillages, des files interminables aux stations-service, et l’arrêt des réseaux de transport en commun.
Parallèlement, la situation des réfugiés afghans a empiré : entre mars et début juillet 2025, plus de 1 million d’entre eux ont été expulsés depuis l’Iran et le Pakistan, selon les données du Haut-Commissariat pour les réfugiés et de l’OIM. Soutenues par la police, les forces Basij ont arrêté des centaines de personnes, dont des réfugiés afghans accusés de collaborer avec le Mossad sur la base de confessions forcées diffusées par les médias étatiques. Cela a ainsi eu pour effet de renforcer un climat de peur et de justifier une expulsion massive de réfugiés dans un contexte de plus en plus xénophobe et critique pour ces derniers.
La diaspora iranienne : douze jours d’angoisse et d’impuissance
Les témoignages qui suivent ont été recueillis par l’auteur entre juin et juillet 2025, dans le cadre d’entretiens informels menés par messages et appels téléphoniques avec des membres de la diaspora iranienne établis en Europe et en Amérique du Nord.
Sepehr, à Amsterdam : « J’étais ici et ma famille était à Téhéran. Je ne pouvais rien faire. Internet était coupé, même un message ne passait pas. Je passais mes journées à lire les nouvelles, à pleurer. Une nuit, à 3h du matin, je me suis réveillé en pensant que peut-être ils avaient bombardé notre maison… »
Ramin, à Vancouver : « Un de nos proches, lié au régime, a été tué par un drone. Le lendemain, le régime a accusé le Mossad d’utiliser des Afghans. Ils ont commencé à les arrêter, à les expulser. Une injustice totale. »
Sara, à Paris : « Ma mère m’a dit qu’ils entendaient les avions de chasse chaque nuit. Ils savent qu’il y a des bases militaires proches, mais ils ne peuvent rien faire. Le régime cache des armes parmi les civils pour que, si Israël frappe, il puisse crier Regardez, ils tuent le peuple ! C’est inhumain. »
Reza : « Après avoir subi plusieurs échecs militaires, le régime a installé des checkpoints et fouille les téléphones lors des passages. Ma sœur avait juste partagé quelques posts contre le régime sur Instagram. Ils ont pris son téléphone, accédé à ses réseaux, puis l’ont arrêtée. Ça fait plusieurs jours qu’on n’a plus de nouvelles d’elle. Aucun appel. Rien. »
Quand le chaos rend justice
Cette guerre a dévasté des vies civiles, et les citoyens sont restés les victimes principales. La situation reste d’ailleurs très instable et il serait légitime d’imaginer une nouvelle escalade entre les deux pays. Cet événement a également souligné la fracture irréversible entre le gouvernement iranien et son peuple. Alors que des généraux ont été parmi les victimes des bombes israéliennes, leur participation à la répression étatique, incluant torture, exécutions, massacres, a exclus tout deuil public à leur égard. Alors oui, cette guerre a montré que le peuple est toujours la première victime. Mais parfois, une certaine justice passe aussi par le chaos. Et la population iranienne, privée d’armes, mais riche de mémoire, a regardé en silence.
Reza Rezaee
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils