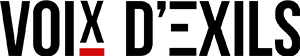L’invisibilité d’une crise mondiale sans précédent
En 2024, les déplacements internes ont explosé sous l’effet cumulé des guerres, des violences politiques, et des catastrophes climatiques. Des millions de personnes à travers le monde ont été contraintes de fuir leurs foyers, souvent plusieurs fois, sans jamais franchir de frontière : une invisibilité qui nourrit l’inaction de la communauté internationale. Le rapport annuel du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que celui de l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC), dressent un état des lieux alarmant de ces flux humains, révélant des chiffres records, des crises prolongées et un système humanitaire en péril.
L’année dernière, 123,2 millions de personnes ont été déplacées de force dans le monde, soit 1 personne sur 67. On parle de déplacement interne lorsqu’une personne est contrainte de quitter son domicile et de se déplacer à l’intérieur des frontières de son pays d’origine, à ne pas confondre avec le terme « réfugiés » qui englobe les personnes traversant des frontières internationales pour chercher un refuge et de l’aide humanitaire. Selon le rapport annuel de l’IDMC, plus de 73,5 millions de personnes ont été contraintes de se déplacer en raison de violences ou de conflits, et plus de 9,8 millions de personnes ont également subi des déplacements internes pour des raisons de catastrophes naturelles. En 2024, 31 nations ont fourni des informations détaillées par région, couvrant la quasi-totalité (98 %) des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, que le HCR affirme soutenir.
Derrière ces chiffres, une réalité brutale : près de la moitié des personnes déplacées survivent dans des zones urbaines souvent saturées, tandis qu’un quart d’entre elles sont confinées dans des camps ou des centres d’accueil collectifs, des lieux trop souvent synonymes de promiscuité, de précarité et d’abandon. La situation est d’autant plus inquiétante si l’on prend en compte les chiffres de 2015, qui ne dépassaient pas les 40 millions de personnes déplacées. Ces dernières se trouvent généralement dans des régions particulièrement instables financièrement. En effet, en 2024, plus de 80 % des déplacés internes vivaient dans des pays dits à faible revenu ou dans des pays à revenu intermédiaire, dépourvus des moyens nécessaires pour répondre à la crise. L’aide humanitaire, bien que chiffrée en milliards, reste en baisse et ne constitue qu’un soutien provisoire.
Des solutions fragiles et inégalement réparties
Le rapport du HCR indique que plus de 8,2 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays sont retournées dans leur région d’origine en 2024, soit le deuxième chiffre le plus élevé jamais enregistré, ce qui représente tout de même une bonne nouvelle. Cependant, l’absence de paix durable entraîne des cycles de retours suivis de nouveaux déplacements, et les solutions à long terme pour les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays restent fragiles. Beaucoup d’entre elles retournent dans leur région d’origine dans des conditions précaires : pauvreté, manque de services publics, insécurité alimentaire et violence persistante. Cela montre à quel point les conditions pour des retours sûrs, dignes et durables sont encore loin d’être réunies dans de nombreux pays.
En Syrie, par exemple, ces retours s’effectuent dans des contextes de grande instabilité. En effet, après la chute du régime Assad en décembre 2024, la dynamique de retour des Syriens s’est fortement intensifiée. Tandis que 7,4 millions de personnes étaient toujours déplacées à l’intérieur du pays en mai 2025, plus de 1 million d’entre elles avaient regagné leur lieu d’origine. Les prévisions estiment qu’environ 1,5 million de déplacés pourraient rentrer dans leur région en 2025. Cependant, la reconstruction du pays reste extrêmement fragile. Les retours se font dans un contexte marqué par des logements détruits, des infrastructures en ruine, une économie instable, et une situation sécuritaire précaire, ce qui complique fortement une réinstallation sur la durée.
Le Soudan, épicentre d’une crise massive
Le conflit soudanais, qui a éclaté en avril 2023 entre les forces armées soudanaises (FAS) et les milices paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR), a engendré la plus grande crise de déplacements internes jamais enregistrée dans le pays. À la fin de 2024, plus de 11 millions de personnes avaient été déplacées à l’intérieur du Soudan, soit une hausse d’environ 27% en un an, contre 9 millions fin décembre 2023. Cela fait du Soudan le pays comptant le plus grand nombre de déplacés internes dans le monde.
Les déplacements se sont concentrés principalement dans des régions spécifiques, comme Khartoum, le Darfour (Sud et Nord) et l’ État du Nil, où des centaines de milliers de personnes ont trouvé refuge, souvent au sein de communautés d’accueil ou dans des camps surpeuplés. À El Fasher, capitale du Darfour du Nord, la violence persistante et le siège imposé par les FSR ont conduit au déplacement de plus de 800 000 civils supplémentaires, exacerbant les tensions dans l’une des régions les plus instables du pays.
La spirale des déplacements internes en Palestine
À la fin de l’année 2024, environ 2 millions de Palestiniens vivaient en situation de déplacement interne dans l’enclave de Gaza, dans laquelle ils faisaient et font toujours face à des besoins humanitaires critiques. Gaza a été ravagée à un niveau inédit : environ 92 % de ses 436 000 maisons ont été touchées ou détruites à la fin de 2024, ce qui explique la proportion importante de déplacements internes de cette population.
Quant à la Cisjordanie, la situation est également dramatique, puisque tout au long de l’année, la multiplication des opérations militaires et des violences des colons a alimenté les déplacements forcés. Les Palestiniens restent confrontés à un climat de contraintes et de pressions, entre restrictions de mouvement, expulsions et harcèlement, accentué par l’escalade de l’offensive israélienne à Gaza. Au total, plus de 3,2 millions de personnes palestiniennes ont été recensées comme victimes de déplacements internes en 2024.
Déplacements et catastrophes naturelles
À la violence des armes s’ajoute celle du climat. En 2024, 45,8 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur de leur propre pays à cause de catastrophes naturelles : un chiffre record qui représente 70% du total des déplacements internes recensés. Derrière ces statistiques, une réalité accablante. En Inde, par exemple, plus de 5,4 millions de personnes ont fui les inondations. Aux Philippines, l’un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles, 9 millions de personnes ont été déplacées en 2024, principalement pour fuir les typhons.
Ces drames ne sont pas le fruit du hasard. Ils frappent en priorité les pays du sud, ceux qui polluent le moins mais qui paient le prix fort de l’inaction climatique des grandes puissances industrielles. Et comme si cela ne suffisait pas, les catastrophes climatiques s’abattent souvent sur des populations déjà déplacées par les guerres, les violences politiques ou les expulsions forcées. Ainsi, ce sont les mêmes victimes que l’on retrouve à chaque crise. Les mêmes vies que l’on sacrifie, encore et encore.
Un système humanitaire au bord de la rupture
Le HCR et les organisations humanitaires ont tiré la sonnette d’alarme concernant les nombreuses coupes budgétaires, qui mettent gravement en péril la réponse humanitaire mondiale. Cette situation a entraîné plusieurs conséquences préoccupantes, notamment la réduction de l’aide alimentaire et des abris, la fermeture des espaces sûrs pour les personnes déplacées, et un frein au retour digne des déplacés internes. À la fin du mois de mai 2025, le HCR disposait uniquement de 23% de son budget annuel, à savoir 2,4 milliards de dollars contre les 10,6 milliards initialement prévus.
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) n’échappe pas à cette tendance puisqu’avec une baisse de près d’un tiers de ses financements, en particulier américains, elle s’est vue contrainte de réorganiser son dispositif mondial. Elle a supprimé environ 20 % de ses effectifs au siège, soit plus de 250 postes, et a transféré certaines fonctions vers des antennes régionales moins onéreuses. Si cette dynamique persiste, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les personnes dépendantes des aides humanitaires et bénéficiaires des programmes de retour, qui continueraient de subir les conséquences de l’inaction des plus puissants.
Rompre le cycle des déplacements internes
Une mobilisation à grande échelle est indispensable alors que les chiffres révèlent l’ampleur historique des déplacements forcés. La crise n’est plus conjoncturelle, elle est devenue structurelle, persistante et profondément enracinée dans les failles de notre ordre mondial. Face à cette réalité, la communauté internationale ne peut plus se contenter de réponses humanitaires ponctuelles ou de promesses non tenues. Elle doit agir sur deux fronts indissociables. D’une part, elle doit s’attaquer aux causes profondes des déplacements, en agissant résolument contre les guerres prolongées, les persécutions ethniques ou religieuses, l’effondrement des institutions étatiques, les violations massives des droits humains et, de plus en plus, les impacts dus au changement climatique. D’autre part, elle doit renforcer la solidarité humanitaire, non seulement par un accroissement urgent et durables des financements, mais aussi par la mise en œuvre de mécanismes de protection efficaces pour les déplacés internes., souvent négligés dans les frontières de leurs pays.
Mohammad Esmaeil et Yahya Nkunzimana
Membres de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils
Sources principales : les deux rapports mentionnés dans le chapeau.
Autres références accessibles via les liens dans le texte.