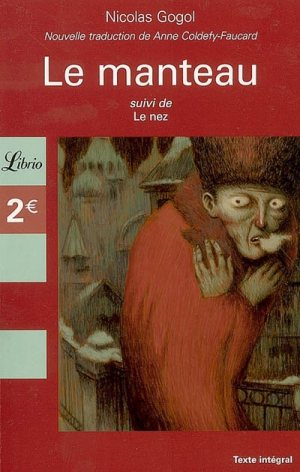Auteur: Byrev. Source: pixabay.com
Est-il possible de s’acheter soi-même?
C’était un événement terrible: il s’était perdu. Aussi clairement et simplement que lorsqu’on perd un objet: son argent, son mouchoir, ses lunettes de soleil ou un bouton arraché de sa veste. Il s’était perdu quelque part. C’était une perte douloureuse, sans aucun doute la plus grande perte de sa vie. On peut à nouveau gagner de l’argent et, avec cet argent, acheter un autre mouchoir, des lunettes de soleil ou, bien sûr, un nouveau costume. On peut rattraper ces pertes très ordinaires. Mais s’acheter soi-même, c’est un problème très compliqué. Dans quel magasin peut-on se rendre et dire au vendeur: « Je voudrais m’acheter »? Sans aucun doute, le vendeur va penser qu’il se trouve en présence d’un fou, va vous regarder avec surprise et peur, s’écarter à la hâte et appeler secrètement la police ou un hôpital psychiatrique pour les informer qu’une personne mystérieuse se trouve dans son magasin. Oui, c’est exactement ce qui va se passer.
Il se débattait dans ses pensées comme un poisson pris dans un filet, mais il ne pouvait pas se rappeler comment il s’était perdu. Après tout, comment était-ce arrivé, où et quand? Pourquoi ne s’en était-il pas aperçu immédiatement? Est-il possible de se perdre ainsi? Est-ce la conséquence d’une intervention divine? Il était déjà convaincu que sa vie était un échec. Pourquoi est-ce que cela lui était arrivé à lui ? Comment allait-il pouvoir désormais soutenir le regard des gens – de ses voisins, de ses parents, de ses connaissances? Tout le monde se moquerait probablement de lui. Et ses collègues, surtout ceux qui lui donnaient sans arrêt des conseils, lui reprochaient de ne pas être un homme de son temps, d’être incapable de communiquer avec le chef, de ne pas vivre comme tout le monde, ceux qui le surnommait « l’amoureux de la vérité » seraient plus enthousiastes encore pour le tourner en ridicule.
Après avoir repassé ces scènes dans son esprit, il se sentit rempli de trouble et se posta devant un miroir : l’homme qui le regardait était bien lui-même, cela ne faisait aucun doute. Sa tête, ses oreilles, son nez, ses yeux, ses mains, ses pieds – tout était en place. Mais de tout son être, son esprit, ses sens, il sentait que quelque chose manquait. Il en était sûr à cent pour cent. Oui, dans le reflet du miroir, tout était en place. Mais dans sa réalité, dans sa vie, quelque chose manquait. Quand il réalisa à nouveau cette dure et amère vérité, son cœur lui fit aussi mal que s’il avait été blessé par balle.
Ce jour-là, il quitta la maison dans la peur et l’anxiété pour aller travailler. Fait intéressant, personne ne soupçonna quoi que ce soit; personne ne se rendit compte de sa perte. Un seul collègue, qui partageait son chagrin, le regarda attentivement et lui demanda avec suspicion:
– Que t’est-il arrivé? Es-tu malade? Tu as l’air très étrange. Tu ressembles à quelqu’un qui a perdu quelque chose de précieux…
Il ne se souvient plus de ce qu’il lui a répondu; il a rapidement coupé court et a quitté son lieu de travail dans une peur étrange.
***
Il s’est alors complètement fermé. Il a d’abord écrit des poèmes. Et même si tout le monde les appréciait, insatisfait de ce qu’il avait écrit, il dit adieu à la poésie pour toujours. Il est ensuite devenu peintre, puis compositeur… Pendant un certain temps, il a aussi travaillé comme apprenti à côté d’un cordonnier. Mais en vain. Des années plus tard, il n’était toujours pas à son aise, il ne s’était pas retrouvé.
***
C’était un jour d’hiver gris. Le ciel ressemblait à un grand tamis que les flocons de neige traversaient. Les mains dans les poches de son manteau, il marchait vite dans le vent. Et le vent, hurlant comme un loup, soufflait la neige et frappait le visage des quelques passants. Après avoir longtemps traversé cette neige et ce vent, il entra dans un café et s’approcha du comptoir.
– A boire!
– Non, paie d’abord tes dettes, tu boiras ensuite. Combien de temps vas-tu boire ma vodka à crédit? – demanda le barman.
– Je paierai bientôt mes dettes. Et maintenant, je t’en prie, donne-moi quelque chose… mon cœur est sur le point d’exploser et je suis sur le point de geler.
– En aucune façon!
– S’il vous plaît…
– Non, j’ai dit non!
Embarrassé, il s’approcha de l’une des tables et s’assit, la tête entre les mains. Deux personnes installées dans le coin le plus éloigné du café se sont murmuré quelque chose. Elles ont appelé le serveur, ont payé toutes les dettes de l’homme au vieux manteau et lui ont recommandé de lui servir autant de boisson qu’il le demanderait. C’étaient deux anciens collègues, parmi ceux qui lui conseillaient d’être un homme de son temps. Maintenant, l’un était devenu le chef et l’autre, le chef du département.
Le chef a dit:
– Vois-tu ce qui lui est arrivé? Quel dommage! C’était un talent inestimable.
– Vous avez raison – a rétorqué le chef du département. C’est la fin de toutes les personnes qui ne se donnent pas de valeur : l’alcool, l’ivresse, une vie dénuée de sens, ruinée.
Ils ne firent pas de mouvement vers lui parce qu’ils avaient honte de le faire devant les gens autour d’eux.
En général, tous ceux qui le connaissaient le traitaient de cette façon: comme s’ils ne l’avaient jamais connu. Tous, autour de lui, les voisins, connaissances, anciens collègues, contemporains, le considéraient comme un homme impuissant et malheureux, un ivrogne. Et le pire, c’est que personne ne s’est jamais rendu compte qu’il se cherchait encore.
Dehors, il neigeait sans arrêt, comme si le but de cette neige tenace était de blanchir la face du monde entier.
Samir Sadagatoglu
Membre de la rédaction valaisanne de Voix d’Exils